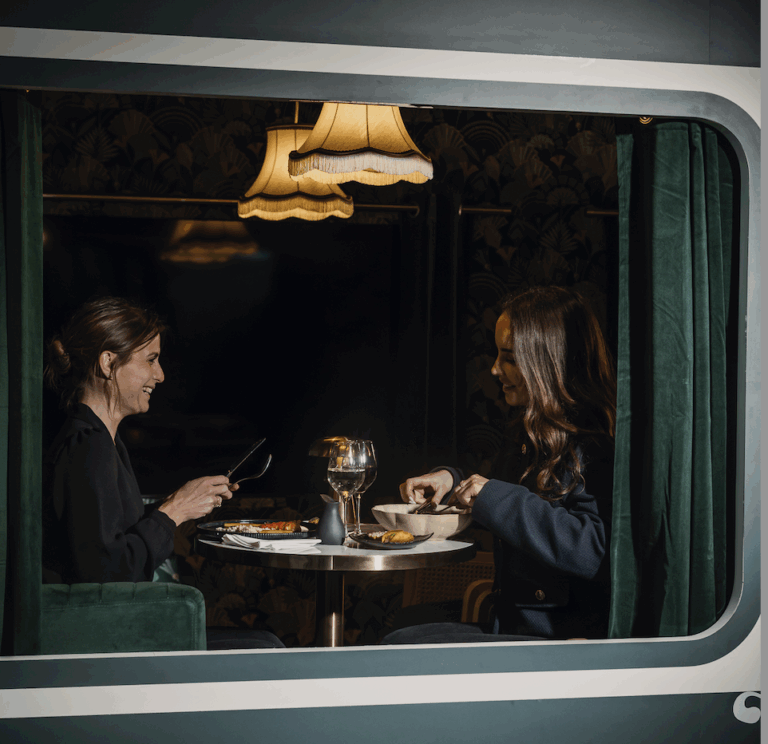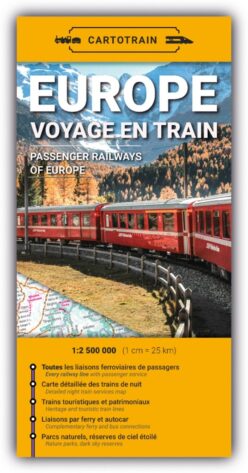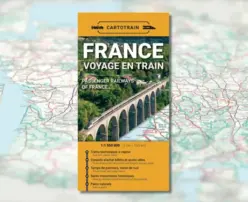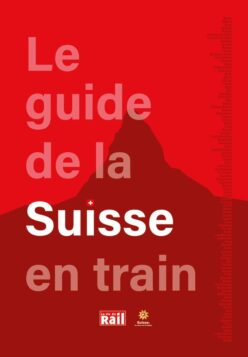L’histoire des transports compte de nombreuses aventures sans lendemain. Voici quatre projets mort-nés dont les vestiges sont toujours visibles et qui constituent aujourd’hui un patrimoine insolite.
L’Aérotrain
Un long rail de béton surplombe toujours la Beauce parallèlement à la voie ferrée de Paris à Orléans. Ce « monument » est l’ancienne piste d’essai de 18 kilomètres construite près de Saran pour tester les capacités de l’Aérotrain. Inventé par l’ingénieur français Jean Bertin, l’Aérotrain avait une ambition : devenir un système de transport léger et rapide pouvant concurrencer l’avion. Développé dans les années 1960 et 1970, le concept de base reposait sur un système de coussin d’air à soufflerie, permettant au véhicule de s’élever réduisant ainsi la friction et permettant des vitesses plus élevées que celles atteintes par les trains conventionnels. L’Aérotrain de Bertin était alimenté par un moteur à réaction, ce qui lui permettait d’atteindre des vitesses élevées.
Le prototype Aérotrain 02 a effectué ses premiers essais en 1969. En 1974, il a établi un record de vitesse en atteignant près de 430 km/h. Malgré ces succès, le projet se heurte à des questions financières et des préoccupations liées à la sécurité. Le décès en avril 1974 du président Pompidou, fervent défenseur de l’Aérotrain, marque un tournant. Valérie Giscard d’Estaing, son successeur, décide de ne pas poursuivre l’aventure. Il préfère un projet de train à grande vitesse conventionnel : le TGV !
En 1977, le gouvernement met fin au financement du projet. La piste d’essai est en grande partie démantelée. L’Aérotrain de Bertin reste un projet inachevé. De cette utopie, reste l’imposant vestige de la Beauce et le souvenir d’une aventure industrielle, symbole d’une époque où les ingénieurs convoquaient le futur. Ainsi, la revue Fiasco a érigé l’Aérotrain en monument de l’échec pour son premier numéro publié en janvier 2023 : « Une ruine moderniste en pleine terre de Beauce. Une vanité contemporaine. Le ratage prophétique de cette matrice pour un programme de « pays utile » qui propulse le monorail vers l’objet de culte, mémorial et autel du ratage. »

Funiculaire de Super-Cannes
Loin de la frénésie clinquante de la Croisette, les hauteurs de Super-Cannes, dominant le quartier de la Californie, profite du plus grand des calmes. Initiée par la Société immobilière de Paris et du littoral, la construction du funiculaire se déroule de 1925 à 1928. C’est la Société Ceretti et Tanfani qui est chargée de construire les gares de départ et d’arrivée du funiculaire. André Capron, maire de Cannes et Yves Le Trocquer, ministre des Transports de l’époque, participent à la cérémonie d’inauguration le 27 janvier 1928. Cette infrastructure permet alors de désenclaver la colline de Super-Cannes et dessert une auberge et un observatoire toujours bien visible depuis l’ensemble de la région. Rapidement, de nombreuses villas sont édifiées sur la colline, leurs habitants profitant d’une magnifique vue panoramique sur la baie de Cannes. La ligne grimpe depuis la gare inférieure, (10, avenue Val Vert), sur 850 mètres à travers le vallon des Gabres. La gare de départ et la gare d’arrivée ont été édifiées dans un style néo-provençal et constituent aujourd’hui un patrimoine en danger. Le funiculaire n’a qu’une seule voie à crémaillère.
Dans les années 1960, l’avènement du tout automobile creuse la tombe du funiculaire, délaissé par les habitants de Cannes et par les touristes. Une usure des mâchoires de sécurité entraîne la fin de son exploitation, qui s’achève définitivement en 1966.
En 1989, les 24 000 mètres carrés de terrains supportant les installations de l’observatoire, du restaurant, de la ligne du funiculaire et de ses deux gares sont vendus à la famille de l’émir d’Abou Dabi, Khalifa ben Zayed Al Nahyane. La municipalité délivre même en 1993 un permis de construire pour l’édification d’une villa de 1 200 mètres carrés reliée à la gare de départ du funiculaire par une voie privée. Mais, le tribunal administratif annule le permis en 1994 car la voie empiète sur le domaine public. Depuis, l’ensemble est à l’abandon… Aujourd’hui, l’immense site offre quelques belles promenades.

Mini-métro de Noisy-le-Grand
C’est l’histoire d’un rendez-vous manqué… Construit à Noisy-le-Grand (93) en un temps record par la RATP entre 1990 et 1993, le mini-métro devait permettre de relier la gare de Noisy Mont d’Est du RER A à un nouveau quartier d’affaires Maille-Horizon-Nord de Seine-Saint-Denis. Mais, celui-ci n’a jamais vu le jour à la suite de la faillite du promoteur immobilier. La petite ligne ne verra jamais passer le moindre voyageur.
Aujourd’hui, si la plupart des voyageurs du RER A l’ignorent, le mini-métro est toujours là, derrière une simple porte noire, abandonné aux tagueurs et amateurs d’explorations urbaines. Avec ses deux stations, son tunnel de 518 m de long et ses cabines, le site offre un large espace mystérieux.
Le mini-métro va bientôt rejoindre définitivement les oubliettes de l’histoire des transports publics et du patrimoine ferroviaire de la banlieue parisienne. Une ultime visite a été organisée en octobre 2023. L’ensemble doit devenir prochainement un tiers-lieu de 2 500 m2 baptisé Station K. La municipalité de Noisy-le-Grand a en effet confié à la Société publique locale d’aménagement, d’équipement et de rénovation des communes de Noisy-le-Grand, Gournay-sur-Marne et du territoire Grand Paris Grand Est (Socaren) un important projet de réhabilitation. Le site devrait alors accueillir un restaurant, un espace de bureau partagé, des espaces de loisirs, des évènements culturels récurrents et même un mur d’escalade de 9 m de haut ! Le nouveau lieu doit ouvrir ses portes à l’horizon 2026.

Le Téléscaphe de Marseille
À l’entrée de la calanque de Callelongue, située à l’extrémité sud-est du VIIIe arrondissement de Marseille, dans le quartier des Goude, d’étonnants vestiges témoignent d’une histoire méconnue. Ces restes de mécanismes sont ceux d’un téléphérique sous-marin. Construit dans les années 1960, il fut nommé « téléscaphe », (un engin entre le « téléphérique » et le « bathyscaphe ») par James Couttet, un ancien champion de ski, et Denis Creissels, un ingénieur spécialisé dans la construction de remontées mécaniques.
Ses cabines vitrées permettaient aux visiteurs de découvrir les fonds marins au cours d’une traversée à dix mètres de profondeur, sur une distance de 500 mètres aller-retour au pied du cap Croisette, le Téléscaphe devait permettre aux visiteurs de découvrir les fonds marins de la baie de Marseille sans se mouiller. Il faut alors débourser 12 francs pour quinze minutes d’immersion. Il en coûterait aujourd’hui environ 75 euros pour un couple avec enfant…
A l’époque de sa construction, le commandant Cousteau était parvenu à fasciner le grand public avec son film documentaire Le monde du silence, réalisé avec Louis Malle, et sorti en 1956 dans les salles obscures. Il reçut la Palme d’or au festival de Cannes et l’Oscar du meilleur film documentaire. Le film a un retentissement immense et crée un engouement important pour la plongée sous-marine.
Inauguré le 26 juin 1967, le Téléscaphe accueille près de 30 000 visiteurs en seulement une année d’ouverture. Mais les coûts d’exploitation et d’entretien trop élevés n’ont pas permis à l’entreprise de trouver la rentabilité souhaitée…